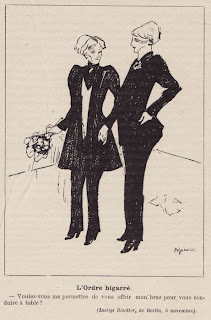Pierre de Massot (1900-1969) est de ces écrivains
qui ont été mêlés à l'histoire littéraire du XXe siècle. Il a
croisé quelques grands noms de notre littérature, mais son œuvre
est passée au second plan, a été oubliée par l'histoire
littéraire. Il a pourtant été proche de Francis Picabia, Erik
Satie, André Breton, André Gide, Henry de Montherlant, Jean Cocteau, etc. Il a été proche des
dadaïstes et a connu avec eux la rupture – violente – avec les
surréalistes.
C'est le hasard de la chine des livres
sur l'homosexualité qui me l'a fait découvrir. Un titre, Mon
corps ce doux démon, une description succincte sur le site
d'enchères où je l'ai trouvé, un tirage restreint, et donc rare,
un petit prix, m'ont convaincu de l'acheter et de le découvrir. Le
hasard ou la chance (ou les deux comme souvent lorsque on recherche
des livres rares) ont mis à portée de mon désir de livres un
exemplaire du très court tirage (55 exemplaires) de l'édition originale, avec ce
portrait par Jacques Villon. C'est lui que je présente aujourd'hui.
Comment qualifier ce livre ? Un seul
mot, technique, le résume : une autobiographie. Mais c'est
réducteur. Un deuxième mot me vient à l'esprit : « confessions ».
Lorsqu'il dit « dans ce livre, il n'est rien que je veuille
dissimuler et ce qu'à l'ordinaire on prend grand soin de cacher,
moins que le reste encore », on croit lire la célèbre phrase de
Jean Jacques Rousseau : « Je forme une entreprise qui n'eut jamais
d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux
montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la
nature; et cet homme, ce sera moi. ». Enfin, et c'est cela qui m'a
plu, c'est un itinéraire de vie, de la vie d'un homme à travers ses
amours, toujours dominés par les besoins impérieux de son corps.
Plus que la biographie d'un homosexuel,
c'est surtout le vie d'un homme, dont les amours se sont partagés
entre les hommes et les femmes, dans une fluidité entre l'amour des
garçons, visiblement très physique et sentimental, et l'amour des
femmes, plus complexe et plus intellectuel (ou cérébral).
Lorsqu'il aborde son enfance au
collège, c'est l'amour des garçons qui prédomine. Au-delà de
l'image classique des amours collégiennes, dont l'époque a été
friande (je ne cite que pour mémoire Peyrefitte ou Montherlant),
c'est surtout la découverte du sentiment amoureux et du plaisir
sexuel.
Peu à peu, le récit nous fait
comprendre que son goût dominant est celui des garçons. L'épisode
avec la petite prostituée Marcelle se termine par ce constat : « il
me semble bien que du point de vue physique je puisse tenir pour
certain qu'en dépit de celles qui la suivirent, la décevante
expérience, avec elle entreprise et qui me laissait sur ma faim, ne
contribua pas peu à augmenter ma réserve à l'égard de son sexe. »
Il nous annonce l'histoire de cet amour qui a marqué sa vie : « je
n'ai dans ma vie connu le plaisir et l'amour conjugués qu'auprès de
celui dont, bien qu'il soit mort, voilà cet octobre douze ans, je
m'interdis de prononcer le nom. Plus tard peut-être je révèlerai
qui était cet être inoubliable et tout ce que je lui dois ».
Pourtant tout la fin de l'ouvrage se termine sur ses amours
tumultueuses avec une jeune écossaise, Robbie, qui se terminera par
un mariage. Dans un passage proustien par l'intrigue plus que par
le style, il nous fait part de son attirance pour les gomorrhéennes
:
La plupart de mes amies sont, pour employer la terminologie de Marcel Proust, gommorhéennes. Non, hasard. Loin de là. Je recherche, j'ai recherché toujours l'amitié des invertis des deux sexes, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent, pour ce qu'ils bénéficient d'une intelligence et d'une sensibilité extrêmement aiguës et que la liberté pour eux n'est pas un vain mot. Aussi quelle joie lorsque Robbie, notre intimité tout à fait établie, m'avoua des goûts, des préférences identiques aux miennes, et aux miens, et que l'attirait instinctivement, et fortement, son propre sexe. Cette dernière révélation m'enchantait : on admettra que dès lors je misse tout en œuvre pour la concréter. Qu'elle couchât avec un autre homme m'eut affligé d'une indicible affliction; il n'en allait pas tout de même de cette sorte de divertissements, je n'y voyais rien que de louable et charmant : sans doute j'énonce une vérité première un peu bien connue, le fait est que je la sentais profondément. Cette vérité d'ailleurs ne convainc point tout un chacun.
Pour revenir sur ses jeunes années, il
insiste beaucoup sur la honte, plus précisément sur la honte sociale
qu'il a connue dans sa jeunesse. Il en conclut :
Et puis on s'habitue à tout, à la honte même. Ayant horreur en général du ton pleurnicheur et, littéralement, du genre « Petit Chose », je ne conterai point ici les vexations, les brimades, les injustices, les brutalités de presque tous ces petits bourgeois riches qui reniflaient en moi le pauvre comme les chacals un cadavre dans la palmeraie. Je ne me vengeais de leur mépris et de leur bassesse que par le travail. Un travail acharné. Un travail rédempteur.
Ce sentiment de honte, qui est presque
libérateur en lui permettant d'aller au bout de lui-même, ne le
conduit pas dans une posture comme celle que l'on rencontre chez
Genet. Nulle provocation, nulle culture du paria, mais plutôt l'idée
que la honte, subie, libère pour aller au-delà vers une honte
choisie. Au demeurant, que l'on ne croie pas que l'ouvrage prenne une
dimension morale. C'est surtout, et cela reste, l'histoire d'un
itinéraire. La honte sociale est celle d'un jeune homme de bonne
famille, mais dans la gêne, mis en contact, par solidarité de
classe, avec des jeunes gens plus riches. Une bonne part de cette
honte se concrétise par la tenue vestimentaire, marqueur du
déclassement de sa famille dans ce milieu de haute bourgeoisie ou
d'aristocratie.
Ce live a été écrit en 1932, alors
qu'il a tout juste 32 ans. Il s'explique guère sur les raisons qui
l'on poussé à l'écrire. On peut y voir un cri du cœur, d'un homme
qui, à un moment de sa vie, veut faire le bilan de son existence.
L'aspect un peu chaotique et mal construit du livre, comme écrit au
fil de la plume, peut le laisser penser. La notation, en fin
d'ouvrage, indiquant qu'il a été écrit en 1932 dans le port de Cannes,
sur le yacht de Francis Picabia, « L'Horizon », renforce
le sentiment d'une œuvre plus spontanée, comme écrite au hasard,
que d'un travail réfléchi, construit et retravaillé. On est dans
de la littérature d'un seul jet, même s'il dit à un moment :
Si ce livre ne présente point l'harmonieuse ordonnance que primitivement je lui rêvais, s'il est divers et touffus, qu'on me veuille absoudre. Il m'a paru, au fur et à mesure qu'il s'élaborait, que je me trouverais mieux, et j'espère le lecteur avec, d'obéir à mon inspiration que de me plier à des règles. Je ne saurais me soumettre à un plan; prospecter à la billebaude me convient davantage. Ce préambule à l'intention de ceux qui s'étonneraient que je n'aie pas débuté par ce chapitre qui traite de l'enfance.
On y trouve aussi une influence d'André
Gide. Rappelant une citation des Nourritures terrestres, il se
réclame des œuvres du dévoilement gidien : Si le grain ne
meurt, par exemple. Doit-on voir dans l'œuvre libératrice de
Gide un aiguillon pour Pierre de Massot l'amenant lui aussi à
procéder à son propre dévoilement ? Il ne le dit pas, mais cela
m'apparaît certain. Cependant, le texte n'a été imprimée qu'en
1959, tel quel, hormis quelques compléments en notes de bas de page.
Pourquoi ce délai ? L'urgence apparue lors de l'écriture n'était
plus aussi vive au moment de l'imprimer ? Difficulté pour aller au bout
d'une démarche personnelle, dans un milieu malgré tout peu
favorable à ce type de liberté d'écriture (rappelons qu'il était aussi un proche d'André Breton) ? Une pudeur vis-à-vis
des personnes citées ? Je ne sais. Lorsqu'il a enfin été imprimé,
d'autres œuvres l'avaient précédé, souvent plus audacieuses,
malgré le retour d'un certain ordre moral après-guerre. Le tirage
est resté confidentiel. L'édition originale sur un beau papier Arches avec
un tirage du portrait gravé par Jacques Villon n'a été imprimée
que « 50 et 5 fois », suivi d'un tirage sur papier
ordinaire à 220 exemplaires « pour l'auteur et quelques
amis ». Cela suffit à expliquer le peu de retentissement de
l'ouvrage et son quasi oubli. Dans les rares notices biographiques
que l'on trouve sur Internet (Wikipédia, par exemple), l'ouvrage
apparaît dans la bibliographie, mais les aspects de sa personnalité
qu'il révèle sont passés sous silence. Pudeur habituelle sur
l'homosexualité de nos écrivains ! D'ailleurs, l'ouvrage est absent
des grandes bibliothèques publiques, excepté un exemplaire dans la
réserve de la BNF.
Une autre raison est peut-être que
Pierre de Massot semblait plutôt aimer les jeunes garçons. Cette
belle description en est la preuve :
De l'époque de cette mue, il me reste et parfois me revient des souvenirs auxquels j'ai plaisir à donner audience. La joie y compose avec la peine, l'espérance avec la mélancolie. Il n'y a pas comme ces souvenirs pour, je l'avoue, m'abreuver de nostalgie mais j'y puise également je ne sais quelle force dont je ne suis point assez présomptueux pour faire fi : grâce à quoi je compte achever sans louvoyer le cours de mon existence. Je veux dire que si quelque fois je me prends à regretter certains corps que j'enveloppais de caresses, c'est tout de suite que je vais à l'aventure pour en découvrir d'autres; et j'en regretterai la sveltesse demain, et les tendres abandons. Ce garçon dont le pantalon si court gante les formes juvéniles et dont autour des paupières le cerne trahit les tourments, si je l'aborde, s'il ne repousse pas mon baiser, c'est pareil à lui un enfant qu'il me rappellera, le soir qu'il se donnait à l'être merveilleux, aux prunelles autant que la voix si étranges, à cet être dont la mort seule l'a séparé sans réussir toutefois à rien distraire de son immense amour...Sa timidité, ses brusques pudeurs, son effarouchement si commençant de se dévêtir, mes mains au plus haut des cuisses fines s'attardent, sa pâleur soudaine, l'ombre émouvante et mouvante des longs cils sur la joue veloutée, ce duvet autour des mollets bruns, c'est moi, c'est bien moi quand, dans la ténèbre abyssale de l'extraordinaire chambre qu'embaumaient des parfums de Syrie, je sentis, avec un bonheur ineffable, que je redoutais de voir tout d'un coup se briser, légères et vives, les paumes du dieu errer sur ma, chair, et qu'alors je crus défaillir. Dieux du ciel ! est-ce donc possible sur cette terre pareil enivrement?... Depuis ce soir, il est vrai, je poursuis sans répit le souvenir de cette heure adorable; André Gide, lui aussi, n'écrit-il pas, dans Si le grain ne meurt, qu'il a jusqu'à ce jour tenté en vain de ressusciter l'enchantement de sa nuit orientale avec Mohamed ? Serait-ce pas la rançon de ce plaisir divin que nous ne le puissions éprouver qu'une fois dans la vie, et que le reste ne soit que course en suite d'une ombre, fuite dans un miroir, jeu des nuées et du vent? Cependant, pour désolé qu'il me laissât, je ne me déprendrai point de ce souvenir aimé et, longtemps encore, j'en quêterai l'insaisissable image sur des visages aimants. Si fort que j'y demeure attaché, j'ouvre quand même des yeux éblouis sur les objets étrangers qui m'environnent, et je ne sache point lui être infidèle, lorsqu'un instant sur eux me penchant, je ne refuse pas leur passagère et charmeresse offrande. Dans ce pourchas continu d'une heure d'ivresse, oh que de surprises souvent ! que d'appâts imprévus! et que volontiers je m'y abandonne!A la campagne, il n'y a guère, je passai deux mois enchantés en compagnie d'un garçon de treize ans dont me ravissait la fraîcheur d'âme et de peau. Ensemble nous vagabondions à travers bois, à travers champs, nous arrêtant sur les bords d'une rivière et là, pour adoucir la brûlure du soleil, dans l'onde s'enlaçaient nos jambes nues. Parfois, à tour de rôle, nous maraudions des fruits, les pêches de vigne surtout, juteuses, chaudes et sucrées, et de pulpe si serrées. Ou bien devisant à l'ombre immobile des sapins, nous attendions que s'atténue la touffeur du jour et que le crépuscule du soir nous permît de redescendre sans fatigue vers le village.Au début, j'éprouvai qu'il n'est point aisé d'avouer à l'enfance : je piétinais et ce fut lui qui, devinant ma gêne et la prévenant, jeta autour de mon cou ses bras, puis me tendit ses lèvres. Dès lors, négligeant artifices et précautions, je mis bas toute espèce de feintise : à quoi bon maquiller une passion dont je le savais lui-même tout brûlant? Il n'était que de l'initier à certaines caresses qu'il ignorait et desquelles je prévoyais qu'il goûterait, autant que moi, la paralysante douceur. Sans hâte, je l'instruisis ; et nul élève jamais n'y montra plus d'empressement et, je puis ajouter, plus de dispositions. Assez promptement, et non sans orgueil, il témoigna de la maîtrise qu'il avait acquise dans un art que je lui révélais et dont je lui avais inculqué les notions premières. Du reste, qu'avais-je à lui apprendre qu'il ne connût obscurément ou pressentît déjà, qui ne vint que comme une réponse à son appel informulé, de sorte que sa gratitude égalait la mienne.Ainsi constitué que peu m'est beaucoup, sous mes doigts le satin de sa peau suffisait pour que m'envahît un émoi délicieux. Je préférais le servir, attiser son plaisir, mais il n'avait de cesse qu'il me le rendît. Et je devais toujours, tant je craignais que l'excès ne l'épuisât, mettre avant notre lassitude un terme, hélas ! à nos enlacements. Toujours, il passait outre et je cédais toujours. Ha! que j'aimais, dans les bois, sur un tapis de mousse, le déshabiller et qu'il se roulât, câline statuette de bronze, entre mes bras ! Et quand recrus de fatigue, ô combien exquise ! nous appareillions de concert vers l'accalmie réparatrice, je pensais à Celui entre les bras, contre le cœur de qui, jadis, nu aussi, je me lovais si tendrement...Je sais aussi bien que quiconque, en contant cela, à quels sarcasmes je m'expose, à quelles critiques, à quelles excommunications, mais on ne me ferait pas, sous la hache du bourreau, venir à résipiscence. Je ne renoncerai jamais ce que je ne réprouve point et que, tout au contraire, j'engage autrui à imiter. Amoralité? sans doute, sans doute; nous en discuterons plus tard. Parce que mes goûts me sont personnels, me contestera-t-on le droit de les justifier ? La norme! j'obéis à celle qu'à tout instant je fonde sur le devenir.
Mais les années 50 étant moins
strictes à ce sujet, ce n'est probablement pas la raison principale.
Je crois qu'il s'agit de ce que j'ai appelé, par euphémisme, la «
pudeur » qui amène à occulter l'homosexualité de nos auteurs,
sauf lorsque c'est vraiment patent, voire porté en étendard (Gide,
Cocteau, Genet, etc.). Pour les autres, peut-être est-ce considéré
comme un passe-temps sans beaucoup d'importance, à l'instar d'une
passion pour les timbres ou les poteries égyptiennes, qui ne mérite
pas d'être signalée. Dommage, cela nous enlève des portraits
d'hommes complets, dans la richesse et la complexité de leurs
désirs.
Ce texte est inégal. Certains passages
m'ont ému : je pense à l'histoire de son mensonge pour avoir la
photo de la classe voisine afin de posséder une image du garçon qu'il aime. J'aime aussi l'histoire de sa première communion où, lorsque sa
mère lui demande pour qui il a prié, il répond « Robespierre ».
Cependant, ce texte donne moins que ce qu'il promet. Il ne faut pas
le négliger. Il n'y a pas tant d'autobiographies d'homosexuels
avant-guerre pour qu'il mérite d'être totalement oublié. Il
restera toujours ignoré jusqu'à ce que quelqu'un le réimprime ou,
plus moderne, le numérise. Sinon, il faudra se contenter d'espérer
le trouver.
Pour finir, cette belle lettre d'André
Gide, de 1934, en avant-propos de ce livre (Pierre de Massot a été quelque temps le secrétaire d'André Gide). Il avait eu le privilège
de le lire alors qu'il n'était que manuscrit. Bel hommage à la
liberté !
Paris, mardi soir.Mon cher Pierre de Massot – Rassurez-vous. Ce que j'aurais à vous dire n'a rien de terrible, bien au contraire. Votre œuvre est si particulière, si personnelle, que j'ai trouvé bien ridicule en y repensant, le conseil que je vous donnais l'an passé, de modifier (par exemple) l'âge de vos personnages pour rendre plus acceptable votre récit. Il n'a pas à être acceptable mais accepté par quelques-uns seulement, qui vous sauront gré tout au contraire de tout ce qui doit le rendre intolérable pour ceux dont l'opinion ne vous importe guère. Le seul reproche que je puisse vous faire, c'est que vous le leur dites un peu trop. J'ai commencé à vous lire avec tremblement et délices. Le tremblement a cessé dès l'instant que j'ai pris le parti de considérer ce manuscrit comme celui de quelqu'un de mort depuis longtemps et à qui cet écrit ne pouvait plus nuire. J'ai compris du même coup que ce tremblement était en fonction de l'affection que je vous portais, qui est vive. Ce mot vous parviendra-t-il assez tôt pour ne pas modifier le rendez-vous que nous avons pris ? Je l'espère, et vous attends donc demain, à 3 heures ou de préférence, 3 heures et demie. Votre bien attentif.André GIDE
Pour aller plus loin sur Pierre de Massot, quelques liens : cliquez-ici ou cliquez-là et surtout ce lien sur un site consacré à Montherlant : cliquez-ici.
Description de l'ouvrage
Pierre de Massot
Mon corps, ce doux démon
S.l.n.n.n.d. [Alès, PAB (Pierre-André Benoît), 1959], in-8° (252 x 164 mm), 66-[8] pp., un portrait gravé en frontispice, en feuilles, chemise.Justification du tirage :
Cet exemplaire contient un bulletin de souscription pour le tirage public à 220 exemplaires, sans le portrait gravé, à vendre à la librairie des Tuileries. Ce tirage est qualifié d'édition originale, alors que l'on peut penser que la véritable édition originale est le tirage sur beau papier de 55 exemplaires.
De nombreuses descriptions de cet ouvrage dans des ventes aux enchères donnent comme lieu et date d'édition : Alès, PAB [Pierre-André Benoît], 1959, sans référence. Je l'ai reprise.
Il a fait l'objet d'un compte-rendu dans la revue Arcadie, n° 75, mars 1960, pp. 198-199, signé Sinclair [René Dulsou (1909-1992), dernier amour de Max Jacob] :
« Livre charmant s'il en fût par le fonds (sic) et la forme.
Cet auteur trop peu connu et dont les écrits sont à l'heure actuelle à peu près introuvables, nous livre quelques confidences sur sa prime adolescence.»
Revenant à l'esprit Arcadie, Sinclair note : « L'intrigue qu'il noue avec un des plus doués parmi ses condisciples est, ainsi d'ailleurs que plusieurs autres, parfaitement retracée et les détails les plus précis ne jettent aucune ombre sur un récit toujours d'une exemplaire tenue. » (c'est moi qui souligne).
Il termine :
« Le burin de Pierre de Massot a gravé là une œuvre dont nous conseillons à tous les Arcadiens (et même aux autres) curieux de belles-lettres, d'entreprendre la lecture et qu'ils ne seront pas près d'oublier.
Je crois qu'il nous remercieront de leur avoir signalé ce livre à la diffusion un peu ésotérique, mais dont les qualités sont trop rares pour ne pas être exaltées. »
De nombreuses descriptions de cet ouvrage dans des ventes aux enchères donnent comme lieu et date d'édition : Alès, PAB [Pierre-André Benoît], 1959, sans référence. Je l'ai reprise.
Il a fait l'objet d'un compte-rendu dans la revue Arcadie, n° 75, mars 1960, pp. 198-199, signé Sinclair [René Dulsou (1909-1992), dernier amour de Max Jacob] :
« Livre charmant s'il en fût par le fonds (sic) et la forme.
Cet auteur trop peu connu et dont les écrits sont à l'heure actuelle à peu près introuvables, nous livre quelques confidences sur sa prime adolescence.»
Revenant à l'esprit Arcadie, Sinclair note : « L'intrigue qu'il noue avec un des plus doués parmi ses condisciples est, ainsi d'ailleurs que plusieurs autres, parfaitement retracée et les détails les plus précis ne jettent aucune ombre sur un récit toujours d'une exemplaire tenue. » (c'est moi qui souligne).
Il termine :
« Le burin de Pierre de Massot a gravé là une œuvre dont nous conseillons à tous les Arcadiens (et même aux autres) curieux de belles-lettres, d'entreprendre la lecture et qu'ils ne seront pas près d'oublier.
Je crois qu'il nous remercieront de leur avoir signalé ce livre à la diffusion un peu ésotérique, mais dont les qualités sont trop rares pour ne pas être exaltées. »
Pour finir en beauté ce message (et sans lien) :